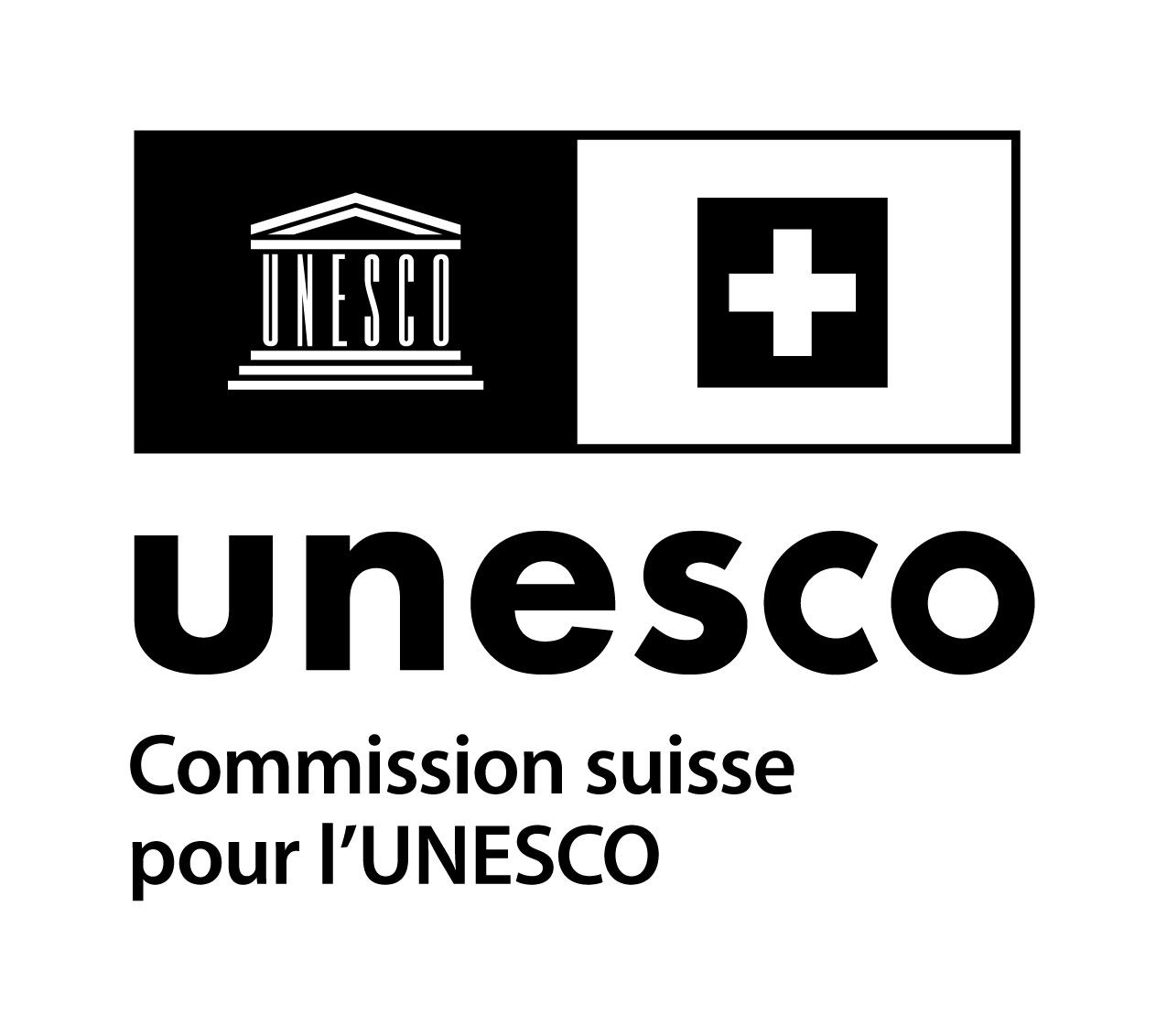Histoire
L’UNESCO ne surgit pas ex nihilo après la Seconde Guerre mondiale. Sa création s’inscrit dans un long processus de réflexion internationale sur la coopération intellectuelle, façonné par les profonds bouleversements du milieu du XXᵉ siècle. Elle résulte à la fois d’initiatives développées dès l’entre-deux-guerres et d’une volonté, affirmée dès 1942, de préparer la période de reconstruction.
Des racines dans l’entre-deux-guerres
Dès les années 1920, la communauté internationale s’efforce de renforcer la coopération intellectuelle entre les nations. Inauguré en 1926 sous l’égide de la Société des Nations, l’Institut international de coopération intellectuelle, basé à Paris, encourage les échanges entre intellectuels, scientifiques et éducateurs. Bien que ses activités soient interrompues par la Seconde Guerre mondiale, il est aujourd’hui considéré comme le principal précurseur de l’UNESCO.
La guerre comme catalyseur
En 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale, les gouvernements de plusieurs pays engagés dans le conflit contre l’Allemagne nazie, dont certains en exil, se réunissent à Londres alors encore sous les bombardements, à l’occasion de la Conférence des ministres de l’éducation. Anticipant la fin du conflit, ces États engagent une réflexion commune sur la reconstruction des systèmes éducatifs. Cette initiative marque un tournant décisif et pose les bases d’une coopération internationale structurée, bientôt étendue à la science, à la culture et à l’information.
Il nous appartient d’ouvrir les voies par lesquelles pourront passer, de peuple à peuple, les grands courants de la connaissance et de la pensée, de la vérité et de la beauté, qui forment l’essence même de toute civilisation digne de ce nom.
Ellen Wilkinson, Présidente de la Conférence fondatrice et Ministre de l’Éducation du Royaume-Uni
Londres, 1er novembre 1945
La fondation de l’UNESCO
Dans le prolongement direct de ces travaux, des représentants de 44 gouvernements se réunissent à nouveau à Londres en novembre 1945 afin de créer une nouvelle organisation intergouvernementale. Trente-sept États signent la Constitution de l’UNESCO. L’Organisation devient officiellement active en 1946, avec l’entrée en vigueur de sa Constitution après ratification par 20 États. La première Conférence générale se tient la même année à Paris, qui est confirmé comme siège permanent. La Suisse rejoint l’UNESCO peu après, en devenant membre dès 1949.
Quelques dates clefs
► Découvrez ici quelques dates clefs de l’histoire de l’UNESCO (cliquez ici)
- 2015: L’UNESCO est désignée comme agence chef de file des Nations Unies pour la coordination de l’objectif de développement durable 4 (ODD4) sur l’éducation de qualité, et adopte le Cadre d’action Éducation 2030.
- 2009: La Conférence générale élit Irina Bokova (Bulgarie) dixième Directrice générale de l’UNESCO. Elle est la première femme à exercer cette fonction depuis la création de l’Organisation en 1945.
- 2003: Adoption de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, marquant une reconnaissance globale des traditions vivantes et du savoir-faire des communautés.
- 2001: La Déclaration universelle sur la Diversité culturelle de l’UNESCO est adoptée par la Conférence générale.
- 1999: Création officielle de l’Institut de statistiques de l’UNESCO (UIS), basé à Montréal (Canada).
- 1997: Adoption de la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme, pionnière dans le domaine de la bioéthique. L’Assemblée générale des Nations Unies la fait sienne en 1998.
- 1992: Création du programme Mémoire du Monde pour protéger le patrimoine documentaire des bibliothèques et fonds d’archives. Il comporte aujourd’hui également des archives sonores, cinématographiques et télévisuelles.
- 1990: La Conférence mondiale sur l’Éducation pour tous, qui se tient à Jomtiem, Thaïlande, lance un mouvement mondial pour fournir une éducation de base à tous les enfants, jeunes et adultes. Dix ans plus tard, à Dakar (Sénégal), le Forum mondial sur l’Éducation engage les États à achever l’éducation de base pour tous en 2015.
- 1978: L’UNESCO adopte la Déclaration sur la race et les préjugés raciaux. Des rapports publiés par la suite sur le sujet par le Directeur général ont servi à discréditer et à réfuter les bases pseudo-scientifiques du racisme.
- 1972: Adoption de la Convention concernant la Protection du Patrimoine culturel et naturel mondial. Ce texte fondateur établit les bases de la protection du patrimoine culturel et naturel commun à toute l’humanité. Le Comité du patrimoine mondial est créé en 1976 et les premiers sites sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en 1978.
- 1970: Adoption de la Convention sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, visant à lutter contre le trafic illégal d’objets culturels.
- 1969: Le Bureau international d’éducation (BIE), fondé en 1925 à Genève et longtemps dirigé par Jean Piaget, devient un institut de catégorie I de l’UNESCO, pleinement intégré à l’Organisation.
- 1968: L’UNESCO organise la première conférence intergouvernementale visant à réconcilier l’environnement et le développement, ce qu’on appelle maintenant le «développement durable». Cela conduit à la création du Programme «L’Homme et la Biosphère» (Man and the Biosphere, MAB) de l’UNESCO.
- 1960: Lancement de la Campagne de Nubie en Égypte pour déplacer le Grand Temple d’Abou Simbel et éviter son inondation par le Nil lors de la construction du barrage d’Assouan. Pendant cette campagne, qui a duré 20 ans, 22 monuments et éléments architecturaux ont été déplacés. Ce fut la première et la plus importante d’une série de campagnes parmi lesquelles celles de Mohenjo Daro (Pakistan), de Fès (Maroc), de Kathmandou (Népal), de Borobudur (Indonésie) et de l’Acropole d’Athènes (Grèce).
- 1958: Inauguration du siège actuel de l’UNESCO à Paris, surnommé « La Maison de l’UNESCO », situé Place de Fontenoy. Conçu par les architectes Marcel Breuer, Pier Luigi Nervi et Bernard Zehrfuss, le projet a été supervisé par un comité international présidé par le Suisse Le Corbusier.
- 1954: Fondation du CERN à l’initiative de l’UNESCO, après des travaux préparatoires lancés en 1950. L’organisation, dont le siège est établi à Genève, devient juridiquement indépendante de l’UNESCO dès l’entrée en vigueur de sa Convention, signée par 12 États européens.
- 1952: Une conférence intergouvernementale réunie par l’UNESCO adopte la Convention universelle sur le droit d’auteur. Dans les décennies qui ont suivi la seconde guerre mondiale, la Convention a servi à étendre la protection du droit d’auteur à de nombreux États qui n’étaient pas parties à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1886).
- 1946: Première Conférence générale de l’UNESCO, dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne. À cette occasion, les représentants des 44 États fondateurs confirment la nomination du britannique Julian Huxley comme premier Directeur général et actent le choix de Paris comme siège permanent. La Constitution de l’UNESCO entre en vigueur.
- 1945: Adoption de la Constitution de l’UNESCO à Londres.
***
Une organisation façonnée par l’histoire
Les évolutions de l’UNESCO témoignent de son rôle d’espace multilatéral traversé par les tensions, les transformations et les réalignements du monde contemporain, mais aussi de sa capacité à maintenir un dialogue ouvert et à intégrer de nouveaux membres. En savoir plus.
L’héritage de l’après-guerre
Dès les premières années de l’Organisation, la composition de ses États membres est influencée par les divisions politiques issues de la Seconde Guerre mondiale. Certains pays n’adhèrent que plusieurs années après la fondation de l’UNESCO, notamment le Japon et la République fédérale d’Allemagne en 1951, suivis de l’Espagne en 1953.
Transformations géopolitiques et élargissement
Au fil des décennies, les grandes évolutions géopolitiques se reflètent directement dans l’adhésion des États membres. Absente lors de la fondation, l’Union soviétique rejoint l’UNESCO en 1954 et, après sa dissolution, est remplacée en 1992 par la Fédération de Russie et douze anciennes républiques soviétiques devenues indépendantes. Dans le contexte de la décolonisation, une vague importante d’adhésions se produit dans les années 1960 : dix-neuf États africains nouvellement indépendants rejoignent l’UNESCO, marquant une étape importante de son universalisation. Des changements de reconnaissance politique interviennent également, comme l’admission de la République populaire de Chine en 1971 qui devient le seul représentant légitime de la Chine à l’UNESCO, ou celle la République démocratique allemande en 1972, qui disparait à la suite de la réunification allemande en 1990.
Retraits et réintégrations
L’histoire de l’UNESCO est également marquée par des retraits temporaires d’États membres, généralement liés à des différends politiques ou budgétaires. En 1957, sous forte pression diplomatique et face aux critiques internationales concernant sa politique d’apartheid, l’Afrique du Sud quitte volontairement l’Organisation, qu’elle ne réintègre qu’en 1994, après l’instauration de la démocratie.
Les États-Unis se retirent une première fois en 1985, invoquant une politisation excessive, avant de réintégrer l’UNESCO en 2003. Ils s’en retirent à nouveau en 2018, à la suite de l’adhésion de la Palestine en 2011, qui avait entraîné la suspension de leur contribution financière, puis réintègrent l’Organisation en 2023. En juillet 2025, ils annoncent toutefois un nouveau retrait, effectif au 31 décembre 2026.
Israël quitte également l’UNESCO en 2018 dans ce même contexte et n’y est pas revenu à ce jour. Le Royaume-Uni se retire en 1986, dénonçant à la fois une politisation excessive et une gestion jugée inefficace, avant de réintégrer l’Organisation en 1997 à la suite de réformes internes.